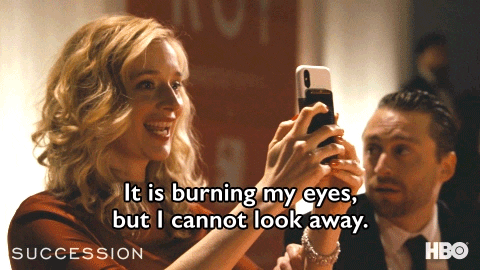Pour certains, la fin d’année est vue comme un moment propice à la générosité. Pour d’autres, difficile de ne pas penser à un mouvement de repli sur soi et les siens (vous avez dit “cocon” ?). Pour ce qui est de cette édition, on va parler d’écrire pour les autres — notamment celles et ceux qui ne nous ressemblent pas.
Au cœur de cette dernière interview de 2021 : inclusion, accessibilité, ainsi que les métiers qui s’articulent autour de ces sujets. Bienvenue dans une discipline dans laquelle écrire revient à se poser un milliard de questions — mais pour de bonnes raisons. Un peu comme moi en cette fin d’année, cherchant mes mots avant de poser le point final de cette édition.
Bonne lecture à tous,
Benjamin
Plumes With Attitude est une newsletter sur l’écriture sous toutes ses formes. Si vous avez envie de suivre cette publication, abonnez-vous pour recevoir les prochaines éditions.
🎙 INTERVIEW… Gladys Diandoki
À chaque newsletter, je vous propose de découvrir le portrait et les idées d’une véritable plume “With Attitude”. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de recevoir Gladys Diandoki, qui travaille à l’intersection du design, de l’inclusion et des mots. Elle vient d’écrire son premier livre, UX Writing, quand le contenu transforme l’expérience, qui sortira le 6 janvier 2022 aux éditions Eyrolles. En voici un avant-goût le temps d’une interview !
Hello Gladys et merci d’avoir accepté l’invitation ! Cette interview précède la sortie de ton livre sur l’UX Writing, qui sera la première publication francophone sur le sujet par une grande maison d’édition. Pour commencer, je voudrais revenir avec toi sur les termes spécifiques à ton métier. Quelle est ta définition de l’UX Writing ?
Écrire ce livre m’a permis de prendre du recul sur la façon dont je vois mon métier. Aujourd’hui, je me considère davantage comme Content Designer qu’UX Writer. Ma mission, c’est de structurer des informations pour les partager au bon endroit et au bon moment dans un parcours. Il ne s’agit pas uniquement des mots. L’UX Writing n’est pas une fin en soi : c’est plutôt une compétence dans ma boîte à outils.
Parler de design n’est d’ailleurs pas anodin. Dans son livre Content Design, l’autrice Sarah Richards dit qu’au-delà de chercher quels mots employer, le véritable enjeu du métier est de déterminer quelles solutions vont répondre le mieux à un problème donné. Ma palette d’outils ne s’arrête donc pas à l’UX Writing, mais comprend des compétences comme la recherche utilisateur, l’accessibilité et l’architecture d’informations.
Je vois aussi mon métier comme la création de parcours d’un point de vue narratif. Cela consiste à se poser de nombreuses questions dans le cadre d’un produit. Quels sont les problèmes des utilisatrices ou utilisateurs ? Qu’est-ce qui se passe quand tout fonctionne ? À l’inverse, qu’est-ce qui doit s’afficher, en créant le minimum de frustrations, quand rien ne marche ? Quelles mauvaises utilisations pouvons-nous anticiper ? Comment donner envie à une personne de passer à l’action ? Ou tout simplement, comment leur parler ?
Tu as mentionné une compétence dont j’avais prévu de parler avec toi : l’architecture d’informations. Peux-tu nous expliquer comment ça marche ?
L'architecture d'informations, c'est la manière dont tu vas organiser ton contenu et tes messages en fonction des besoins des utilisatrices et utilisateurs, de tes enjeux business, et de ton univers de marque. Une fois que tu commences à y réfléchir, tu comprends que c’est vraiment partout autour de nous. Ça s’applique aussi bien à l’expérience dans une application mobile que dans un parcours de visite d’un musée, mais aussi dans le développement de l’intrigue d’un roman ou la construction de l’univers d’un jeu vidéo.
C’est vraiment là que tu fais appel à tes compétences de storytelling et de stratégie. Tu dois hiérarchiser tes messages et créer différents scénarios et niveaux d’informations pour faire entrer les personnes concernées dans l’histoire que tu veux raconter. L’enjeu, c’est de distiller la bonne information au moment opportun pour créer de la tension, de l’intrigue ou dans mon cas, pour aider les personnes à trouver l’information qu’elles sont venues chercher.
En l’espace de deux ans d’existence de la newsletter, j’ai pu voir ces métiers gagner du terrain. Cette année, j’ai l’impression d’avoir relayé des offres d’emploi en UX Writing ou Content Design à chaque édition. D’où vient cet engouement récent pour ces postes au sein des entreprises tech ?
On s’est souvent demandé avec Kat Boyer et d’autres : à partir de quand s’est-on dit qu’on pouvait construire des expériences sans personne pour s’occuper de la narration ? Dans la publicité par exemple, il y a toujours eu d’un côté la conception-rédaction pour s’occuper des mots, et de l’autre la direction artistique pour créer un univers visuel. C’est un noyau créatif qui a toujours bien fonctionné par sa complémentarité. Donc la vraie question, c’est surtout : pourquoi avoir oublié si longtemps cette compétence centrale au sein des équipes Produit ?
Aujourd’hui, je pense qu’on doit sa réintégration à une plus grande maturité de l’user experience (UX) et plus précisément de la recherche. L’application de tests d’utilisabilité a montré aux équipes Produit qu’une meilleure hiérarchie de l’information, ou même le simple fait de bien choisir ses mots sur une interface, peut résoudre de nombreux problèmes — et donc faire passer l’expérience au niveau supérieur. Pouvoir expliquer avec clarté et concision chaque étape d’un parcours, créer une cohérence globale dans l’expérience, embarquer des personnes dans un univers : c’est ce qu’on attend normalement d’une équipe Design. D’où l’intérêt d’y intégrer les métiers du contenu, de nous permettre de contribuer au Design System tant au niveau éditorial qu’au niveau des composants, et de conduire nos propres tests. Car le maillon de la chaîne créative qui avait disparu, c’était bien nous.
Pendant longtemps, la norme en vigueur dans l’écosystème start-up a été le mantra des débuts de Facebook, “move fast and break things”, caractérisé par l’omniprésence du growth-hacking. Bien sûr, ça a eu un impact phénoménal qui se voit encore aujourd’hui dans notre façon d’écrire et de communiquer en ligne. As-tu le sentiment que l’UX Writing est là pour réparer les travers de cette culture ?
C’est marrant, j’en parle dans l’introduction de mon livre. J’y évoque l’anecdote de Kristina Halvorson, qui fait partie des pionnières de la Content Strategy. Elle explique qu’à leur arrivée chez Facebook entre 2009 et 2010, les nouveaux Content Strategists avaient placardé des affiches dans les bureaux : “Slow down and fix your shit”. La priorité allait auparavant à la mise en production constante de nouvelles fonctionnalités, sans se soucier de la cohérence de l’expérience globale. Et ce que les Product Designers de l’époque cassaient à l’époque, c’était notamment tout ce qui avait trait à l’information et au contenu. D’où cette idée de ralentir et de réparer les morceaux cassés.
Il y a deux obstacles à contourner quand on est UX Writer ou Content Designer. Le premier vient du fait de travailler avec des personnes qui ne comprennent pas toujours ton métier et son utilité. Le second, c’est de leur faire comprendre que tu ne dois pas arriver en bout de chaîne dans le développement produit. Intégrer le Content Design en amont te permet de poser les jalons narratifs de la même façon qu’un Product Designer le fait pour les éléments visuels. Ça te permet de raconter une histoire, et pas seulement de servir un contenant. Donc oui, ça a forcément un impact sur la culture d’une équipe. Au début, on peut ralentir le rythme de production, mais c’est pour mieux reprendre de la vitesse par la suite, en délivrant des expériences complètes. Et bien sûr, cela permet de prendre en compte des enjeux clés tels que l’accessibilité.
Justement, j'allais y venir ! Car derrière cette montée de l’UX Writing dans les entreprises, il y a tout un mouvement sociétal vers plus d'accessibilité et d’inclusion au quotidien. J’ai parfois cette impression que l’enjeu central est de trouver des façons de communiquer plus universelles. Mais est-ce que pour les entreprises, ça n’irait pas à l’encontre de cette volonté de personnaliser toujours davantage les expériences en ligne ? Dit autrement, peut-on concilier personnalisation et accessibilité ?
En fait, la personnalisation mène à l'accessibilité. Ces problématiques me passionnent et montrent que l’UX Writing va bien au-delà de l’écriture. Il est vrai que quand tu commences à parler inclusion et accessibilité, tu dois gommer certains éléments pour rendre ton expérience universelle. Tu vas notamment utiliser un langage inclusif pour adopter une façon de parler dégenrée et non sexiste, raciste ou validiste. L’idée, c’est que personne ne ressente de micro-agressions dans sa propre expérience du produit.
Pour cela, on doit penser en termes d’alternatives. Ce sont des éléments de personnalisation destinés à faire en sorte que personne ne se retrouve exclu. Et quand on travaille sur des problématiques d’inclusion et d’accessibilité, il est question de vécus et de traumas — pas seulement de mauvaises expériences avec un produit.
Exemple typique : je trouve ça dérangeant de ne pas pouvoir me laver les mains dans certaines toilettes publiques parce que le capteur qui fait couler l’eau ne reconnaît que les peaux claires. Ça en dit long sur le manque de diversité dans les entreprises qui développent ces solutions, dans la mesure où des personnes non blanches n'ont pas été prises en compte dans les panels de tests.
C’est un exemple qui illustre aussi que les alternatives ne se traduisent pas uniquement par du texte. Pour une personne daltonienne, sourde, aveugle ou qui aurait des troubles de l’attention, on va réimaginer l’expérience parfois juste en travaillant bien la lisibilité. Pour certaines, ce sera avec un texte alternatif, d’autres des textures différentes, ou encore une version audio. Dans l’espace public, l’accessibilité fait partie intégrante de notre quotidien. Mais on a tendance à ne pas le remarquer tant qu’on n’est pas concernés.
J’aimerais revenir sur ta distinction entre langage inclusif et écriture inclusive. Peux-tu m’en dire plus sur ton approche du sujet ?
L’inclusion par l’écriture doit aller beaucoup plus loin que le seul prisme de la relation homme-femme. Si tu prends en compte le genre, l’écriture dite “inclusive” n’intègre pas les personnes trans et non-binaires. De nombreuses discriminations peuvent être véhiculées par le langage.
On ne se rend pas compte de l’omniprésence du validisme dans nos façons de parler — en disant “c’est schizo[phrénique]” par exemple. Tout comme on ne devrait pas dire “une sourde” ou un “aveugle”, étant donné que ces maladies ne constituent pas l’identité d’une personne. Mieux vaut donc basculer ces termes en adjectifs et plutôt parler de “personne sourde”.
Le livre Don’t Make Me Think, de Steve Krug, a une approche qui est devenue un véritable mantra pour moi. C’est l’idée de faire en sorte que personne n’ait à réfléchir ou à se poser de question face à un texte. Quand on réalise un achat ou une démarche administrative en ligne, on doit pouvoir aller au bout du processus sans avoir à penser discrimination parce qu’un élément va nous y inciter.
Ça me rappelle justement un passage de mon interview avec Camile Promérat, qui comparait l’UX Writing à “l’art d’écrire pour ne pas être lu”.
La mission de l’UX Writing est effectivement d’aboutir à une expérience si fluide qu’on n’a pas besoin d’accorder d’importance au texte. La démarche d’inclusion va également dans ce sens : on va chercher à éliminer tous types de discriminations. L’idée, c’est de ne pas en rajouter une couche par rapport à ce que ces publics vivent déjà au quotidien.
Sauf que les produits tech sont à l’image des personnes qui les conçoivent. Les problèmes d’accessibilité ne sont pas dus à de mauvaises intentions, mais au manque de diversité au sein des entreprises concernées. Quand tout le monde se ressemble au sein d’un groupe, on a tendance à oublier que d’autres personnes vont souffrir des discriminations qui résultent de cette homogénéité.
Reste qu’on ne doit pas faire de l’inclusion juste pour faire de l’inclusion. Certains prérequis sont indispensables, comme le fait d’avoir une culture interne de la recherche et des tests d’utilisabilité. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter un groupe de personnes plus hétérogène à des panels si on ne sait pas quoi en faire.
Pour moi, la recherche doit guider tout ce que l’on fait. C’est aussi bien valable pour des journalistes que pour une équipe Produit. Tu dois nécessairement parler aux gens sur qui tu écris ou pour qui tu conçois. Et quand tu commences à faire des entretiens avec des personnes qui n’ont pas le même vécu, la même expérience, tu es amené à développer ton empathie. Si tu les écoutes comme le ferait une chercheuse ou un chercheur, c'est-à-dire sans jugements, il faut accepter que certaines expériences puissent te perturber, que ce soit en découvrant des visions du monde différentes des tiennes ou en réalisant tes propres biais.
Voilà qui me semble une conclusion parfaite à notre interview. Merci beaucoup pour cette conversation, Gladys ! Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, et aussi beaucoup de succès pour la sortie de ton premier livre.
4 bons réflexes pour un langage plus inclusif, par Gladys :
Se demander qui on exclut : “C’est important de se poser la question. Que ce soit en tant que groupe ou comme individu, nos privilèges sont autant d’opportunités d’exclusions.”
Penser impact, pas intention : “Votre intention est centrée sur vous, ce qui compte est l’impact pour les personnes qui reçoivent le message.”
Ne demandez pas aux personnes discriminées de vous éduquer : “Il existe des milliers ressources (livres, documentaires, conférences, etc.) : faites vos devoirs.”
Se positionner en chercheur(se) : “En recherche, on écoute sans juger. On anticipe pour éliminer nos biais et utiliser ces enseignements pour concevoir et réaliser nos prochaines recherches.”
🔮 KNOWLEDGE IS POWER… Maintenant vous savez !
Avec les derniers textes en date des invités passés (et futurs ?🤞) de la newsletter.
Nom de plume : La fin de mon interview avec Fadeke Adegbuyi faisait la part belle à la montée de l’anonymat et de l’utilisation d’identités multiples en ligne. Si c’est un sujet que vous avez envie de creuser, celle-ci vient de développer sa réflexion dans un nouvel article de sa publication Cybernaut.
Règne des orateurs : Après la sortie de son livre sur le sujet, Clément Viktorovitch a donné une excellente leçon de rhétorique (de plus de deux heures !) sur Thinkerview. Cela va sans dire, je vais tout faire pour l’inviter l’an prochain. Et si jamais vous voulez m’aider, c’est un cadeau de Noël que j’accepte volontiers.
Cryptospective : Sorti quelques jours après la publication de notre interview, cet article de Kyle Chayka (Dirt) et sa co-fondatrice Daisy Alioto est une mine d’or pour toutes personnes intéressées par l’avenir des médias à l’ère de Web3.
Teaser :
🎣 PETITES ANNONCES… Missions freelances & CDI
Pour relayer une mission freelance ou une offre en CDI : benjamin.perrin.pro@gmail.com
Ornikar recrute un(e) Content Designer.
WeMoms cherche un(e) Copywriter.
Qare recherche un(e) Rédacteur-trice Web.
Skello recrute un(e) UX Writer.
Médianes cherche un(e) Chef(fe) de Projet.
Nénés recherche un(e) Chargé(e) de Communication.
🗣 MEANWHILE… L’actu de la communauté
Et vous, ils ressemblent à quoi vos projets du moment ? Écrivez-moi pour m’en parler et apparaître dans la prochaine édition : benjamin.perrin.pro@gmail.com
Judith a créé le Parental Challenge.
Eliott a publié son premier livre, The Social Token Revolution.
Amélie a lancé sa newsletter indépendante.
Louis a écrit un article sur les DAOs.
Elena prône l’éloge de l’incertitude.
Adrien a publié une nouvelle, Le Miroir de Méduse.
Léa a reçu un prix en partenariat avec le magazine Grazia.
Brice détaille le calcul du bilan carbone de son entreprise.
Marine dépoussière les fanzines.
DERNIÈRE CHOSE…
C’était la vingtième et dernière interview de 2021 !
Dans la prochaine édition, je vous propose de revenir ensemble sur une année entière de conversations avec mes chers invités toutes plus géniales les unes que les autres. J’ai déjà hâte de vous partager ce petit rituel que j’avais beaucoup aimé l’an dernier.
Enfin, c’est promis : je vais essayer d’envoyer la prochaine newsletter plus tôt que le soir du 31 cette année. 😇
May the words be with you,
Benjamin
P.S : Retrouvez toutes les newsletters précédentes dans l’archive de Plumes With Attitude. Et si vous avez aimé cette édition, n’hésitez pas à la partager autour de vous, ainsi qu’à vous abonner pour recevoir les suivantes par e-mail.