J’accorde beaucoup d’attention, non sans superstition, au choix de la plume qui ouvre le bal en tant que premier invité de l’année. Et le moins que je puisse dire pour cette nouvelle édition, c’est que 2023 démarre en fanfare. Si bien que l’interview-fleuve de cette newsletter a eu raison de la rubrique de l’actu des lecteurs — qui revient bientôt.
Il en va de même pour cet édito, qui a le mérite de me faire dire l’essentiel plus tôt. Et donc de vous souhaiter, sans plus attendre, une bonne année, pleine de joie, de belles lectures, de projets d’écriture pourquoi pas, et autres plaisirs variés.
Et si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez peut-être que je vous ai récemment parlé de mon envie d’aller davantage au contact de la communauté. Chose promise, chose due : l’invitation est lancée [en fin d’édition] pour se rencontrer en chair et en plumes. Alors pour celles et ceux qui peuvent, je vous dis à la semaine prochaine pour un festival qui met à l’honneur mon média de cœur : la newsletter.
Bonne lecture à vous,
Benjamin
Plumes With Attitude est une newsletter sur l’écriture sous toutes ses formes. Si vous avez envie de suivre cette publication, abonnez-vous pour recevoir les prochaines éditions.
🎙 INTERVIEW… Timothée Parrique
À chaque newsletter, je vous propose de découvrir le portrait et les idées de véritables plumes “With Attitude”. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de recevoir Timothée Parrique, qui est un économiste et chercheur spécialiste de la décroissance. Il y a quelques mois, il sortait un livre aussi sensé qu’encensé sur le sujet : Ralentir ou Périr (Seuil). Et pour cette première édition de 2023, je suis heureux de commencer l’année avec l’une des interviews les plus denses jamais publiées dans la newsletter.
Hello Timothée et merci d’avoir répondu à l’invitation ! Depuis la publication de Ralentir ou Périr en septembre 2022, tu as largement contribué à remettre la décroissance sous le feu des projecteurs. Ceci dit, ça reste terme assez méconnu que j’ai moi même tendance à associer à un autre dont on entend beaucoup parler, à savoir la sobriété. Alors pour commencer, quelles sont les différences entre les deux concepts ?
La sobriété est un terme plus spécifique que la décroissance. En ce moment, on l’associe beaucoup à la sobriété énergétique du point de vue de la consommation. On a tous en tête ces incitations récentes à baisser le chauffage ou à moins utiliser la voiture. Mais se concentrer sur la consommation est insuffisant au vu de l’ampleur des changements nécessaires.
Encourager les Français à moins prendre l’avion, c’est bien. Mais aller au bout du raisonnement, c’est mieux. Il faut donc aussi — et surtout — fermer des lignes aériennes, et ainsi opter pour un renoncement de production. Cela ne veut pas dire qu’on va produire et consommer moins à tous niveaux, mais plutôt que les changements de comportements inhérents à la transition écologique résulteront en un ralentissement général de l’activité économique.
Dirais-tu que parler de sobriété dans un discours politique est avant tout un prétexte pour ne pas parler de décroissance ?
La sobriété est un mot fourre-tout qui n’a pas de véritable filiation intellectuelle. Tout le contraire de la décroissance, qui repose sur une littérature scientifique riche de plus de 600 articles académiques et une généalogie encore plus riche. Dès les années 1970, on retrouve des précurseurs comme Ivan Illich, Cornelius Castoriadis, André Gorz ou encore Françoise d'Eaubonne. D’autres penseurs comme Serge Latouche et Paul Ariès ont théorisé la décroissance au début des années 2000 en partant des travaux de nombreux autres objecteurs de croissance.
Parler de sobriété te permet donc de contourner tout ce courant de pensée et de te réfugier dans une petite zone d’ombre où chacun fait ce qu’il veut. C’est un terme qui a déjà commencé à perdre de son sens et à se faire diluer dans la novlangue capitaliste. À côté de ça, la décroissance est un concept plus exigeant. Cela part d'un constat simple : celui du dépassement des limites planétaires, mais en y ajoutant des contraintes démocratiques, ainsi que de justice sociale et de bien-être.
Donc si on veut revenir dans le vert, il faut s’en donner les moyens. En ce sens, j’aime comparer la décroissance à un régime macroéconomique. Car l’enjeu est bel et bien de se mettre à la diète. Et pour cause : toute activité économique est plus ou moins directement liée à des pressions sur l'environnement. Ce n’est pas seulement une question de consommation d'énergies fossiles, mais aussi d'utilisation de l'eau et des métaux, avec des répercussions sur les sols, sur l'air et sur la biodiversité. Donc c’est très bien de nous encourager à moins prendre la voiture, mais ce ne sera pas suffisant. Car si à côté de ça, tu continues l’élevage intensif ou la construction d’infrastructures pour la 5G, tu ne fais que déplacer le problème vers d’autres secteurs.
D'où l’intérêt de la décroissance pour agir sur l’ensemble du métabolisme économique d’un pays comme la France. Un bon point de départ serait de cartographier tous les impacts de notre économie sur l'environnement. Comme tu te doutes bien, il y a pas mal de points qui nous mettent dans le rouge vis-à-vis du climat et de la biodiversité. Pour chacun d’entre eux, il faudrait donc résoudre les problèmes avec tous les leviers disponibles : gains d’efficacité, renoncements de production, sobriété dans la consommation, partage des usages, etc.
À noter que le dernier rapport du GIEC parle de “sufficiency”. Une traduction plus pertinente serait donc la suffisance, qui est un terme utilisé par le pionnier de l’écologie politique André Gorz dans son livre L’Éloge du Suffisant. Celui-ci le définit comme un concept d’autolimitation qui évoque l’objectif d’un niveau de vie à la fois décent et juste. C’est à l’opposé de “l’illimitisme”, que Françoise d’Eaubonne qualifiait de déni des limites. Rappelons au passage que le premier objectif de l’économie devrait être de satisfaire les besoins humains, à savoir des besoins limités mais néanmoins vitaux : avoir assez de nourriture pour bien manger, un logement suffisamment confortable, des moyens pour se déplacer, un accès aux soins et des médecins disponibles quand on tombe malade, etc.
Et sur ce point, quel besoin vient satisfaire la publicité ? Réponse : elle permet aux entreprises de vendre davantage et donc d’augmenter leurs profits. C’est tout. Alors pourquoi gaspiller autant de ressources humaines et naturelles pour faire tant de publicité ? Et pourquoi tolérer ce matraquage quotidien et tous ses effets néfastes sur le bien-être ? D’autant plus que cela ne bénéficie qu’à l’enrichissement de quelques centaines d’entreprises.
En parlant de publicité j’avais une question assez liée. Car entre les cols roulés de Bruno Le Maire et les pièces jointes d’Agnès Pannier-Runacher, je trouve que notre gouvernement a un vrai talent pour ringardiser l’écologie. Reste que je suis assez partagé sur la question. D’une part, tourner le sujet en ridicule me semble plus desservir la cause qu’autre chose, mais de l’autre ça a le mérite de l’installer davantage dans le débat public. Quel est ton avis sur le sujet ?
J’ai envie de te répondre avec une référence que tu n’attendais probablement pas dans notre échange : Scary Movie (rires). Il y a une scène dans laquelle une fille essaie d'échapper au tueur masqué et se retrouve face à un vaste choix d'armes posées sur une table. Il y a une massue, une hache, un flingue, un taser, une banane. Et si tu as bonne mémoire, tu te souviens peut-être qu’elle choisit… la banane ?! Je trouve que ça illustre parfaitement les choix de notre gouvernement en matière de lutte face à la menace climatique.
Le pire, c’est qu’on a pas mal d'outils à notre disposition. Je pense notamment aux travaux de tous ces chercheurs qui ont travaillé pendant des années sur la collapsologie, sur la post-croissance, sur la décroissance ; à notre secteur de l’économie sociale et solidaire très développé, et j’en passe. Tout ça pour concentrer le discours actuel sur le fait de mettre des pulls et… se laver les mains à l’eau froide ?! Autant dire que les moyens ne correspondent pas du tout à l'ampleur du problème.
J’avoue que je ne pensais pas forcément retrouver Scary Movie dans une conversation autour de la décroissance (rires). Mais après tout, pourquoi pas ! Ça me permet même d’entrer dans le vif du sujet. Pour toi, la décroissance est entrée dans ta vie en 2016 en tant que sujet de thèse. Quelle a été la réaction côté université quand tu as choisi de consacrer quatre années de recherche à une école de pensée encore aujourd’hui marginalisée ?
Pendant des décennies, une grande majorité d’économistes a intégré l'hypothèse que la croissance était désirable, que le but de leur métier était de comprendre d'où elle venait et de chercher comment la stimuler. C’est comme s’ils se prenaient pour des pompiers qui, en relançant la croissance, ont l’impression d’éteindre des feux. Alors quand j’ai annoncé mon intention de passer les prochaines années de ma vie à étudier la décroissance, on m’a pris pour un fou. Pourquoi faire une thèse sur la décroissance quand on a décrété que c’est l’exact opposé de ce que l’économie est censée faire ?
Résultat : j’ai eu beaucoup de mal à trouver des financements, ainsi qu’une université pour accueillir mes travaux. Et même quand mon sujet de thèse a été accepté, le milieu académique a continué à me considérer comme une nuisance intellectuelle. Pourtant, j’étais convaincu d’avoir mis le doigt sur quelque chose. Car c’est une question qui mérite d’être creusée. Ça me semble essentiel d’ouvrir de nouveaux agendas de recherche vers des écoles de pensée qui ont besoin d’être revisitées — surtout à une époque où la croissance est plus controversée que jamais.
Alors qu’on la pensait source de richesse et même le cœur en de tout processus civilisationnel, elle est de plus en plus assimilée à une force destructrice. De la même façon, les économistes se sont longtemps rêvés pompiers alors qu’ils ont été entraînés toutes ces années à se comporter en véritables pyromanes. D’où l’intérêt de déconstruire toute cette économie basée sur la croissance et de se demander comment prospérer sans. La bonne nouvelle, c’est qu’on a plusieurs décennies de théories post-capitalistes, post productivistes et anti-utilitaristes sur lesquelles s’appuyer.
Entre le début de ta thèse et la publication de Ralentir ou Périr, il s’est passé six années au cours desquelles le monde a énormément changé. Comment la perception académique et publique de la décroissance a-t-elle évolué sur cette même période ?
Cette période a hélas été rythmée par de nombreuses catastrophes environnementales, ainsi que par des rapports du GIEC toujours plus alarmants. À l’échelle de mon travail, je pense forcément à la publication du rapport Decoupling Debunked en 2019, qui a démystifié l’hypothèse du découplage — et dont la couverture représente la croissance verte sous les traits du monstre du Loch Ness. Ce qui m’a particulièrement marqué, c'est ce vide intersidéral suite à la sortie du papier. Avec mes co-auteurs, on a démontré qu’il était tout bonnement impossible de verdir la croissance. Et jusqu’ici, personne n’a réussi à nous prouver le contraire — oui, même les économistes.
L’autre grande tendance de fond, c’est l’explosion de la littérature sur la décroissance. On est passé d’une trentaine d'articles par an en 2014 à une centaine en 2022. Il y a aussi eu des best-sellers qui ont popularisé le sujet. Je pense notamment à Décroissance : Vocabulaire pour une Nouvelle Ère (2015) signé Giacomo D’Alisa, Federico Demaria et Giorgos Kallis ; à L’Économie du Donut (2017) de Kate Raworth ; ainsi qu’à Less Is More (2020) de Jason Hickel.
Enfin, ce qui a surtout changé selon moi, c’est que la réalité nous a rattrapés. Toutes ces catastrophes ont donné raison à celles et ceux qui ont tiré la sonnette d’alarme dès les années 1970. Je trouve ça juste fou que les réflexions les plus avant-gardistes de notre époque datent d’un demi-siècle ! Et ce qui est encore plus dingue, c’est qu’on a complètement ignoré ces visionnaires qui nous prévenaient que le capitalisme était un moteur de destruction du vivant, ainsi qu’un obstacle indépassable à la soutenabilité.
À ton échelle, c’est par l’écologie que tu es allé vers la décroissance ?
Il y a pas mal de portes d’entrée vers la décroissance. Pour moi ça n’a pas été l’écologie mais plus improbable que ça : l'économie. Déjà en tant qu’étudiant, je trouvais qu’il y avait une contradiction assez troublante entre les lois du vivant, de la biologie et de la physique d’une part, et celles qu'on utilise dans nos modèles économiques de l’autre. Et il y a de quoi s’étonner, dans le sens où l’économie reste un système réel, avec des humains, des animaux, des matériaux, de l’énergie. Donc si elle vient bafouer les règles du vivant, c’est qu’il y a sans doute un problème quelque part.
C’est ce qui m’a amené à me pencher davantage sur la question. Et je me suis rendu compte qu’en plus d’être erronés, nos hypothèses sur la croissance sont dangereuses — car elles nous font agir de façon complètement irresponsable. Aujourd’hui encore, un certain nombre d’économistes affirment sans sourciller qu’il ne faut pas agir trop radicalement face changement climatique… parce que cela ferait baisser la croissance ?! Dis-toi qu’il y a même des “experts” qui conseillent les politiques en mesurant les retombées des feux de forêts sur l’économie. On a totalement inversé la hiérarchie de ce qui devrait être important et je trouve ça très inquiétant.
Alors d’une certaine façon, c’est par la colère que je suis entré dans la décroissance. Ça m’a semblé urgent de développer une pensée critique vis-à-vis de notre modèle économique, pour la simple et bonne raison qu’on marche sur la tête. La planète est en train de brûler, les plus vulnérables sont les premiers à trinquer, et on ose se féliciter en parlant de progrès pour quelques points de PIB — en large partie accaparés par les plus riches.
Reste que pour combattre le rouleau compresseur néolibéralo-capitaliste, j’ai eu besoin de m'équiper. Je suis allé puiser dans des théories hétérodoxes pour me protéger de la pensée économique dominante. Je me suis donc plongé dans l'économie marxienne, féministe, institutionnelle, dans les pensées décoloniales, dans l’anthropologie économique, dans les courants post-extractivistes et anti-utilitaristes, et bien sûr dans l'économie écologique. Je devais me constituer une boîte à outils pour espérer démonter le logiciel actuel qui légitime et entretient la destruction du vivant.
J’imagine qu’appeler à un changement de système t’a attiré un bon nombre de détracteurs. Et comme tu remets au goût du jour des courants de pensées longtemps marginalisés, j’imagine qu’on te dit souvent que tes idées relèvent de l’utopie. Que réponds-tu à ce genre de critique ?
En tant que doctorant, on ne se débarrasse jamais vraiment du fameux syndrome de l'imposteur. C’est presque un réflexe de se dire qu’on a tort et que ce sont les autres qui ont raison. Et c’est d’autant plus vrai quand tu choisis de s’attaquer à un sujet ultra controversé sur lequel 99,9% des gens te disent que eu as tort avant même que tu écrives ton premier mot.
C’est avec ce doute permanent que j’ai travaillé sur ma thèse pendant quatre ans — ce qui m’a d’ailleurs forcé à être extra-rigoureux. J’ai ensuite passé les deux années suivantes à écrire Ralentir ou Périr, en vérifiant une fois de plus l’argument de fond en comble. Fait inespéré : le livre rencontre un succès public et critique, et a déjà été réimprimé huit fois. Depuis sa sortie, j’ai dû être invité à plus de 130 événements, que ce soit en grandes écoles, dans des podcasts, sur des plateaux TV, et même au sein d’entreprises du CAC 40.
Et ce qui m’a le plus étonné, c’est que les idées du livre n’ont pas vraiment été critiquées — ce que je trouve à la fois perturbant et inquiétant. C’est comme si je braquais un casino façon Ocean’s Eleven, mais qu’il n’y avait pas de sécurité. Même dans les grandes entreprises, j’ai été surpris de voir notre cher capitalisme très peu défendu. C’est devenu un système zombie : théoriquement mort, mais qui continue à vivre sous perfusion. J’ai eu à plusieurs reprises le sentiment de me retrouver face à un grand récit du passé qui a complètement perdu de sa validité et en lequel plus grand monde ne croit. La charge de la preuve est en train de changer de camp. Mais comme tu dis, ça ne m’empêche pas d’avoir des détracteurs — même si la plupart d’entre eux ne savent pas ce qu’est la décroissance. Sinon on ne me demanderait pas aussi souvent si je souhaite à la France de vivre ce qui s’est passé au Vénézuela…
Reste qu’il y a des inquiétudes légitimes autour de la décroissance. Par exemple, comment concilier le financement des services publics et l’État providence avec une contraction importante de l'économie marchande ? Comment éviter un chômage subi dans certains secteurs en transition ? Comment favoriser la transformation des entreprises en coopératives ? Ce sont de vraies questions qui méritent d’être posées et sur lesquelles on est nombreux à travailler. Mais ce ne sont pas des critiques qui mettent en péril le bien-fondé de la décroissance.
Forcément, il y a une autre question que j'ai envie de te poser sur la décroissance : par où on commence ?
Pour moi, il y a deux grands chantiers. Le premier, c'est le démantèlement du capitalisme et de la rationalité économique qui va avec. Et cela devrait selon moi commencer par la suppression des incitations à produire et à consommer. Aujourd’hui, ces deux actions sont stimulées intentionnellement. C’est le cas de la publicité et de l’obsolescence programmée côté consommation, mais aussi de la recherche de profits comme incitation à produire toujours plus.
Il faut donc commencer par sortir de cette organisation de la société qui nous incite à produire et consommer à l’infini dans un monde aux ressources finies. Et c’est essentiellement une question de choix politique, dans le sens où ce n’est pas si compliqué en pratique. En 2015, Grenoble s’est débarrassé des panneaux publicitaires dans l’espace public. Et en ce début d’année, la métropole de Nantes en a retiré une centaine dans la nuit du 4 au 5 janvier 2023. Je pense qu’on devrait appliquer ça partout tant cela relève du bon sens. Techniquement, on peut débarrasser la France de tout son apparatus publicitaire public en quelques jours.
Je ne suis jamais allé ni à Grenoble ni à Nantes, et je ne savais pas du tout. Raison de plus pour y aller bientôt ! (rires) En tout cas, c’est une belle illustration pour montrer que “quand on veut, on peut” — à condition d’avoir le courage politique.
Aujourd’hui en France, la publicité c'est 1-2% du PIB — contre 5-6% de hausse de la consommation. Il faut aussi voir le gâchis en temps de cerveau disponible, avec toutes ces personnes qui pourraient mettre leurs compétences en design, en communication ou en stratégie à des fins plus utiles à la société. Donc pour moi, on devrait tout simplement s’orienter vers une suppression graduelle de la publicité.
Il y a aussi la question de la lucrativité des entreprises. Sur ce volet, l’économie sociale et solidaire peut nous aider. On peut imaginer repenser le fonctionnement de nombreux acteurs en repartant de statuts empruntés aux entreprises à lucrativité limitée, aux entreprises non-lucratives voire même aux coopératives. L’idéal, ce serait de les voir adapter leurs modèles économiques à des enjeux de bien-être et de satisfaction de besoins humains. Là aussi, ça me semble relever du sens commun — n’en déplaise à Milton Friedman qui considérait que la seule raison d’être d’une entreprise était de faire de l’argent.
Une fois qu’on a supprimé toutes ces incitations à croître, on peut passer au deuxième chantier : faire baisser d’autres leviers de production et consommation. Prenons un exemple concret : l’instauration de quotas carbone. Car on ne réussira pas à sortir des énergies fossiles avec une simple taxe — ou pire, en attendant que les marchés prennent une décision. On devrait donc fixer un plafond d’émissions pour la France, avec des quotas carbone à répartir de façon équitable et juste. Il faudrait sans doute imaginer un marché secondaire avec des mécanismes spécifiques. Mais l’idée, ce serait de ne pas dépasser un certain nombre de tonnes émises — qu’on serait amenés à réduire chaque année pour décarboner progressivement l’économie.
Voilà donc une façon de commencer à organiser la décroissance. Évidemment, cela implique d’accompagner des secteurs comme l’industrie, l’automobile ou encore l’aviation commerciale, qui seraient inévitablement amenés à décliner. On aura également besoin d’imaginer des stratégies d’accompagnement du personnel, de formation et de réduction du temps de travail pour s’assurer que la décroissance se fasse sans casse sociale.
J’imagine que ce sont des points que tu as pris le temps de développer dans ta thèse. Et à ce sujet, figure-toi qu’on m’a demandé à plusieurs reprises de faire une édition sur cet exercice d’écriture si particulier. Je profite donc du fait de t’avoir en interview pour te demander : comment passe-t-on d’une thèse de 800 pages, pensée pour des experts, à un livre de 300 pages destiné au grand public ?
C’est une porte que tu vas regretter d’avoir ouverte (rires). Déjà, il faut savoir que j’ai écrit ma thèse en anglais — qui est la langue dans laquelle je travaille en tant qu’économiste. C’était donc une certaine gymnastique intellectuelle que de penser à mon sujet en français pour l’écriture de Ralentir ou Périr.
Ensuite, il faut savoir que je ne m’étais fixé aucune limite de pages pour ma thèse, The Political Economy of Degrowth (2019) — ce qui a pu faire grincer des dents certains universitaires. Le plus important pour moi, c’était que la réflexion soit aussi solide que possible. J’avais besoin d’être exhaustif et je peux te dire que je n’y suis pas allé de main morte sur les notes de bas de page (rires).
Bien sûr, je n’avais pas ce luxe dans le cadre de l’écriture de mon livre. Car cette fois-ci, j’avais bel et bien une contrainte de nombre de pages. Au-delà de la longueur, je me suis fixé l’impératif de rendre mon propos plus accessible et inclusif. Il y a donc eu un énorme travail de vulgarisation. J’ai notamment choisi de remplacer les nombreux concepts détaillés dans la thèse par des analogies et autres exemples plus parlants.
Pour moi, l'écriture c'est l’articulation d’une pensée qui n'existait pas avant d'être rédigée. Les idées naissent et se développent entre les lignes. Leur essence est donc contenue dans notre façon de les exprimer. En ce sens, synthétiser un texte aussi long qu’une thèse revient aussi à développer ses idées autrement. Le livre n’est d’ailleurs pas le dernier niveau de synthétisation d’une réflexion. J’ai notamment dû apprendre à faire tenir mes idées en quelques minutes. Car c’est le temps qu’on te donne lors d’interventions à des plateaux TV ou sur certains réseaux sociaux.
Cet exercice de synthèse a également pour but d’inclure de nouvelles personnes dans la discussion, ainsi que de les inviter à creuser tes idées. Par exemple, notre interview donnera peut-être envie à des personnes de lire le livre. Et ainsi de suite : parmi celles-ci, certaines voudront peut-être approfondir des passages en allant chercher dans la thèse. Donc il y a toujours des ponts à faire à tous les niveaux, avec cet objectif que personne ne se retrouve jamais devant une porte fermée.
D’ailleurs, je me demandais : tu avais prévu dès le début d’écrire Ralentir ou Périr après ta thèse ou ça s’est décidé en cours de route ?
C'était mon plan depuis le début. À quoi bon passer quatre ans de sa vie sur une thèse si c’est pas pour que personne ne la lise ? Je trouve ça terrible de voir que le nombre de téléchargements de certains travaux de recherche se compte parfois sur les doigts d’une main.
De mon côté, j'ai eu de la chance : beaucoup de personnes ont lu ma thèse. Reste qu’en tant que chercheur, je considère que c’est aussi mon rôle d’adapter ma réflexion à différents formats — à commencer par le livre — puis de la rendre accessible lors d’événements et sur les réseaux sociaux.
C’est comme ça qu’on finit dans des newsletters obscures sur l’écriture (rires).
Ton invitation tombait à pic ! Car j’ai une véritable passion pour l'écriture académique. Tu n’imagines pas le temps et l’importance que j’accorde à l’utilisation d’adverbes, de signes de ponctuation ou encore de notes de bas de page. Pour moi, ce sont des éléments structurants dans la construction et la formulation de mes idées.
Et même dans une thèse de 800 pages, dis-toi que j’ai pensé et retravaillé chaque phrase avec une attention si particulière que ça ressemblerait presque à une démarche esthétique. On pourrait comparer ça à ce cliché d’un tableau qui ne serait pas terminé sans ce fameux dernier petit coup de pinceau qui va tout changer. Au fond, je fais pareil à mon échelle avec mes textes. J’ai besoin de choisir mes mots et signes de ponctuation avec soin pour atteindre l’équilibre parfait dans ma réflexion.
Hélas, on considère souvent l'écriture académique comme une écriture morte. On la compare davantage à des rapports d’analyse ou des manuels d'utilisation qu’à de la littérature — et c’est bien dommage. Alors que pour moi, c'est une écriture extrêmement vivante et organique. Car au fond, la qualité de ta réflexion va dépendre du choix des mots et de la façon dont tu les agences.
Aujourd’hui, il y a une crise de l'écriture chez les scientifiques. Et s’ils s’orientent vers des sujets riches et passionnants, nombreux sont ceux qui ne savent pas en parler à l’écrit — et ne réussissent donc pas à transmettre leur passion. Prends n’importe quelle revue d’économie, de physique ou de philosophie et tu auras de fortes chances de tomber sur des articles imbitables. Entre le jargon scientifique à foison, les détails superflus ou les choix d’adverbes très douteux, ce n’est pas seulement qu’on ne comprend pas, mais aussi que rien ne nous encourage à nous y intéresser davantage.
Pourtant, l’écriture académique a un devoir de clarté. Quand tu publies un article scientifique, l’objectif c’est de transmettre une connaissance. Mais si personne ne comprend ce que tu as écrit, alors tu n’as pas rempli ta mission. Je ne crois pas à cette idée répandue qui donne à penser que plus ce que tu écris est compliqué, plus ça prouve que tu es intelligent. À quoi bon rêver que des chercheurs débattent pendant des siècles sur l’interprétation d’une note de bas de page dans ton texte ?
Alors aujourd’hui plus que jamais, les scientifiques doivent sortir de leur trou. Et ce n’est pas qu’une question de vulgarisation. Car c’est tout aussi important qu’ils acceptent des interviews dans les médias, qu’ils se rendent à des événements, ou encore qu’ils se rapprochent d’autres disciplines. On a besoin d'une science qui dépasse les portes du monde universitaire.
Forcément, ça m’évoque Tout comprendre (ou presque) sur le climat, qui est né de la collaboration entre le CNRS et Thomas “Bon Pote” Wagner. Comme Ralentir ou Périr, c’est un livre qui fait la part belle à la vulgarisation, avec de nombreux schémas et infographies mis en avant. C’est aussi un autre exemple de succès public et critique en librairie malgré un sujet pointu. De ton côté, j’ai l’impression que tu es invité un peu partout en ce moment. Ce qui m’amène à te demander : malgré une actualité chargée qui ne s’y prête pas forcément, y a-t-il eu des rencontres ou événements qui t’ont donné de l’espoir récemment ?
J’ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens formidables depuis la sortie du livre. Et ce qui me donne de l’espoir, c’est justement cette énergie incroyable qui se dégage de leurs projets. Je pense par exemle aux Territoires zéro chômeurs de longue durée, ainsi qu’à plein d’autres acteurs de l’économie sociale et solidaire. La recherche aussi est en pleine ébullition ; notamment du côté de l’écoféminisme, dont j’ai pu parler avec Eva Sadoun lors d’un événement récent au Centre Pompidou ; du post-travail, dont parle Céline Marty dans son livre génial, Travailler moins pour vivre mieux ; de l’échange inégal, au cœur des études de Jason Hickel et de plusieurs collègues ; ou encore de la sécurité économique, par Benoît Borrits.
Cette énergie, on la retrouve aussi chez ces étudiants qui appellent à la rébellion. Que ce soit à AgroParisTech, à Centrale Nantes ou à l’EDHEC, je trouve ça intéressant de retrouver cette résistance dans des lieux où la tendance est plus souvent de défendre le système en place. Il y a également toute cette énergie contenue dans les mouvements récents de désobéissance civile. Quoi qu’on en dise, les activistes et scientifiques qui jettent de la soupe sur des tableaux ou s’allongent sur des routes prennent le risque d'aller en prison — voire plus que ça — au nom de leurs convictions. Je pense à ma collègue Julia Steinberger, qui a failli se faire écraser par un camion lors d’un blocage à Lausanne pour militer pour la rénovation thermique.
Maintenant, il est plus important que jamais de connecter toutes ces énergies. Surtout qu’il y a des failles dans le système en place, avec notamment ces personnes haut placées dans les multinationales et gouvernements qui commencent elles-mêmes à douter. J’en ai rencontré et je le répète ici : c’est tout à fait acceptable de s’être trompé et de changer d’avis. La remise en question, c’est la compétence première qu’on t’apprend en tant que chercheur. Si la culture scientifique donnait raison à celles et ceux qui n’ont jamais tort, alors la science ne ferait que stagner.
C’est pourquoi je suis totalement à l’aise avec l’idée que quelqu’un démonte mon livre sur la base d’arguments scientifiques. Je suis prêt à entendre que je me suis trompé et surtout à reprendre mes recherches sur de nouvelles bases théoriques. Et si je ne reçois pas de critiques valides, comme ça a été le cas pour mon rapport contre la croissance verte, alors ça voudra dire que mon travail a permis à la discipline d’avancer. Le problème aujourd’hui, c’est qu’une grande majorité d’économistes refusent le débat de la décroissance, sous prétexte qu’on ne parlerait soi-disant pas la même langue. C’est pourquoi je fais tout mon possible pour qu’on ne puisse plus balayer d’un revers de la main ce courant de pensée aussi essentiel. Par chance, je suis de nature optimiste et toutes ces rencontres me donnent de l’énergie à moi aussi.
Et je te confirme que cette énergie est très contagieuse. En tout cas, PWA commence l’année sur les chapeaux de roues grâce à toi. Alors un grand merci Timothée pour cette conversation passionnante et je te dis à très bientôt !
4 interviews de PWA sur des sujets voisins :
PWA #61 avec Thomas Wagner : sur la lutte contre l’inaction climatique
PWA #58 avec Fanny Vedreine : sur la remise en question du patriarcat
PWA #44 avec Vincent Cocquebert : sur notre civilisation du cocon
PWA #41 avec Rebecca Amsellem : sur le besoin d’utopies féministes
🔮 ET À PART ÇA… Dans le radar !
Entre belles invitations et potentielles bonnes résolutions.
Le Festival de l’Infolettre : Avis aux plumes franciliennes, rendez-vous jeudi 2 et vendredi 3 février à Ground Control ! Au programme : des sujets passionnants pour tout amateur de médias indépendants, avec d’ailleurs un certain nombre d’invités et lecteurs de PWA. Vous m’y retrouverez moi aussi [le vendredi] pour un atelier de conception de newsletter, ainsi qu’une table ronde — bien entouré — sur Web3 et les médias.
Amazonies Spatiales : C’est le nom de la résidence d’écriture du troisième type lancée par Matrice, une chouette association que je viens de rejoindre à temps partiel. Récits prospectifs, thématique spatiale, rencontre avec des artistes et scientifiques : même si je suis forcément biaisé, force est de reconnaître que le programme a de quoi faire rêver. Alors ne tardez pas trop à aiguiser votre plume si vous comptez envoyer votre candidature à la résidence avant le 20 février.
DERNIÈRE CHOSE…
Flemme de trouver des bonnes résolutions ? En voici une toute prête pour 2023 : prenez le réflexe d’écrire aux plumes que vous aimez lire. Croyez-en mon expérience, ça fait chaud au cœur. Même que ça a valu à certains d’être invités dans la newsletter.
Alors si vous voulez me partager vos impressions sur cette nouvelle édition, deux solutions : m’envoyer un e-mail (benjamin.perrin.pro[a]gmail.com) pour les timides, ou relayer cette newsletter dans vos médias et sur vos réseaux pour les aficionados.
Un grand merci à celles et ceux qui prendront la plume pour me répondre, et surtout…
May the words be with you,
Benjamin
Retrouvez toutes les éditions de PWA sur ma page Substack. Et si vous avez aimé cette newsletter, pensez à vous abonner pour recevoir les suivantes par e-mail.

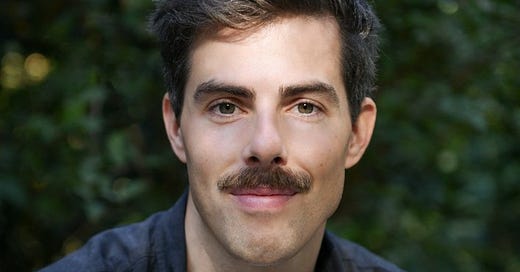


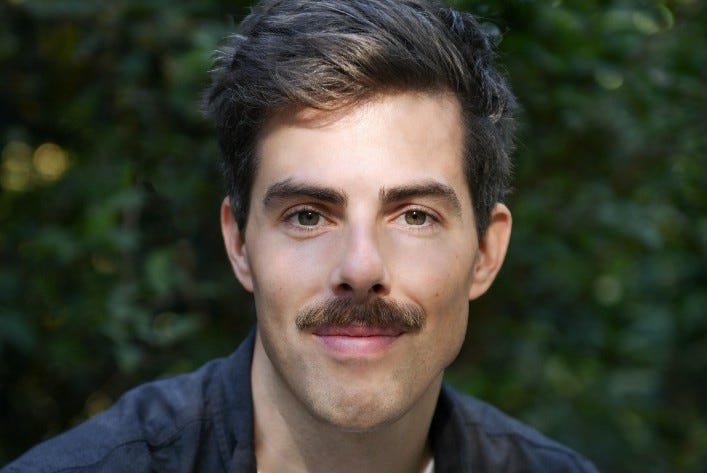

J'aime la réflection, on est tous d'accord : une société zombie, théoriquement morte mais qui est encore animée par nos habitudes, le marché, les états, ...
Après, quand il parle des solutions, je suis pour le moins dubitatif.
Le problème c'est la publicité ? Mais il y aura toujours de la publicité, tant qu'il y aura de la propriété privée !
Des quotas carbone ? Ca existe aussi ! Ca s'est effondré en 2008 en Europe.
Et enfin la cerise sur le gâteau, j'ai écrit un livre à 20 balles parce que personne n'allait lire ma thèse. Pourquoi pas en format libre pdf sur internet ? Sacré décroissance, j'espère que c'est en papier recyclé.
Désolé d'être rabat-joie mais quand je vois des gens faire leur beurre sur des études qui existent depuis les années 60, le tout recouvert de bien-pensance, je suis légèrement sceptique.